Joyeux Noël ! Bonne année ! Et la santé bien sûr ! Ah bah, tiens, en parlant de santé, je vous propose de boire un cou. (première vanne pourrie de 2019)
Après avoir vu l’adaptation de Coppola, après avoir binge-watché Castlevania sur Netflix, après avoir fini deux jeux de la même série (dont l’éternel Symphony of the Night pour la trouze-millième fois), une réalisation implacable s’empara de moi : je n’avais absolument jamais lu le livre originel du mythe de Dracula.
Ni une, ni deux, je me suis précipité dans la librairie la plus proche pour acheter l’édition J’ai Lu qui se vante d’être la seule traduction intégrale existante (ce qui, entre nous, me surprend quelque peu, mais je ne suis pas allé vérifier l’exactitude de la chose, je vous avouerai que je suis très amateur de la couverture de cette édition, donc je leur pardonne s’ils racontent des cracs). Première surprise, de taille : le nombre de pages. Nullement impressionné par la tâche à accomplir, j’étais seulement loin de me douter (au regard du film de Francis) que Dracula comptait plus de 750 pages. C’est qu’il devait y en avoir des choses à dire !
Deuxième surprise, totalement inattendue : le livre est écrit sous la plume de plusieurs narrateurs différents et prend la forme d’un recueil de journaux intimes, de correspondances épistolaires ou – en de rares occasions – de coupures de presse. Une idée intéressante dans la théorie, mais qui montre les limites de l’auteur assez rapidement. On peut distinguer trois narrateurs majeurs (Jonathan et Mina Harker, puis John Steward) auxquels s’ajoutent des narrateurs plus discrets (Lucy et Van Helsing), ce qui aurait pu donner l’occasion d’une variété bienvenue n’apporte au final pas grand chose. Stoker ne change absolument pas de style d’un narrateur à l’autre ou si peu qu’on a parfois besoin de revenir en arrière pour être sûr de savoir qui raconte l’histoire.

Outre ce défaut quand même assez flagrant, l’idée de ces écritures intimes tient sur le fait qu’elles sont couchées sur papier a posteriori (oui, c’est une évidence, je sais). Des invraisemblances découlent fatalement de cela quand un narrateur retranscrit le discours d’un personnage à la virgule près, en reprenant sa façon de parler (mais Stoker ne fait la distinction qu’entre les basses classes qui parlent comme des gueux et les héros nantis qui causent vachement bien). Personnellement, je ne sais même plus ce qu’on m’a dit ce matin, alors vous faire une retranscription détaillée, n’y comptez pas.
Mais bon, ça, c’est pour la forme du livre et les failles qui y sont liées, passons au vif du sujet. Pourquoi déjà le démonter alors que nous sommes en face d’un livre fondateur de l’imaginaire fantastique sur lequel se basent encore livres, séries, films et jeux? Parce que le mythe Dracula a dépassé avec le temps son origine. Auréolé de tout ce qu’on croit savoir dessus, et parce qu’il est ancré profondément dans l’imaginaire collectif, le Comte Dracula a su vampiriser son audience (hoho, elle était facile, mais je la garde).
Pour autant que dire de ce livre qui démarre formidablement bien sous la plume de Jonathan Harker, dans une ambiance macabre à souhaits, angoissante et érotique tour à tour, mais qui retombe comme un soufflet quand le lecteur se coltine un retour plombant en Angleterre aux côtés de Lucy et Mina? Ah ben, je l’ai dit en fait. Dracula propose vraiment un début parfait à tout point de vue, mais s’essouffle au premier changement de narrateur. Pour autant, tout n’est pas à jeter, puisque, même si Lucy n’a pas d’intérêt particulier, Mina est une femme forte et courageuse autant que faire ce peut dans un monde ultra machiste (ce que Stoker rappelle inlassablement en parlant de virilité, d’hommes forts et puissants toutes les trois pages, provoquant soupir et exaspération du lecteur de notre époque au passage). Elle est reconnue et admirée par les protagonistes masculins, même s’ils ont tendance à ne pas souhaiter exploiter ses talents (on va quand même rester entre couilles, bordel).
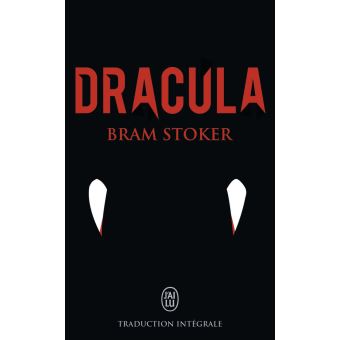
Léger bémol sur l’écriture de certains personnages donc, qui semblent n’être l’incarnation que d’un seul trait de caractère (Quincey, Art, Lucy) et soit ne paraissent pas spécialement utiles au récit (à l’exception d’un passage ou deux, mais qu’il aurait été aisé d’attribuer à un autre personnage principal sans altérer l’histoire), soit ne bénéficient pas de la part de Stoker d’une attention un peu plus poussée (Lucy, une fois les choses avancées, pouvaient obtenir un traitement un peu plus consistant ; de la même façon, le Comte – omniprésent au début – devient trop éthéré au bout de 100 pages et sa menace ne se fait plus étouffante comme auparavant. Trop de mystère tue le mystère.). On sent parfois les limites de l’auteur face à la tâche qu’il s’est imposé et, malheureusement, cela touche également la fin de l’ouvrage qui, une dizaine de pages avant la fin fait montre d’un suspense soutenu… Pour s’achever sur un affrontement anti-climatique au possible et expédiée à la va-vite.
Il faut reconnaître à Stoker d’avoir su installer de prime abord cette ambiance palpable et c’était vraiment bien fichu, cependant son écriture ne tient pas la distance et le récit finit par trop s’étirer (d’autant plus que sur 750 pages, je suis sûr qu’on peut en retirer 100 de phrases mises bout à bout où les personnages se plaignent ou vantent le courage des autres, je n’en pouvais plus à la fin). Mais voilà, ces 100 premières pages sont ce qui est passé à la postérité et ça n’est pas plus mal, quand on y songe, c’était vraiment bien. Faut juste s’arrêter là.
N. B. : l’édition J’ai Lu est criblée de coquilles en tout genre, rien de mieux pour sortir le lecteur du récit (déjà que…). Pas bravo !

